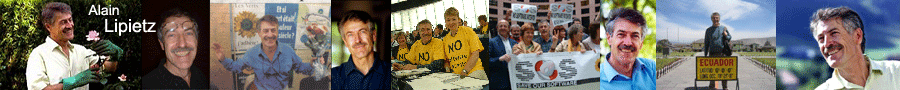-
Syndiquez-vous
-
 Articles
Articles
-
 Blogs
Blogs
-
 Forums
Forums
-

votre référence :
[2002f] “ Qu’est ce que l’économie sociale et solidaire ? ”, intervention aux Etats Généraux de l’Ecologie Politique, Aix-en-Provence, 23 février 2002.
(art. 950).par Alain Lipietz | 23 février 2002
Qu’est ce que l’économie sociale et solidaire ?
|
[2002f] “ Qu’est ce que l’économie sociale et solidaire ? ”, intervention aux Etats Généraux de l’Ecologie Politique, Aix-en-Provence, 23 février 2002.
|
“ Tout d’abord, je vous remercie d’être là si nombreux, bien que ce soit (en tout cas à mes yeux de nordique qui passe son temps à Bruxelles) déjà le printemps. Je pense d’ailleurs qu’il y a un certain rapport entre l’écologie d’une part, l’économie sociale et solidaire d’autre part et le printemps, probablement. Claudel disait : "Le fruit est pour l’homme, mais la fleur est pour Dieu et la bonne odeur est tout ce qui naît."
Je crois qu’effectivement l’écologie nous invite à regarder ces choses qui naissent avec une sympathie tout à fait particulière. Un journaliste me demandait tout à l’heure : “ Est-ce que vous n’avez pas l’impression que, l’économie solidaire, c’est la marge qui risque d’être récupérée ? ”
Oui. Mais en principe tout ce qui naît vise à s’imposer un jour et à devenir la forme normale. Nous sommes actuellement dans une situation où l’Économie Sociale et Solidaire est encore dans la marge, c’est la fleur, c’est ce qui naît. Et un jour elle va porter ses fruits et un jour, ça va être la forme normale, je l’espère, plus exactement la forme dominante du type d’économie que l’on veut construire.
Était-ce par rapport à cette ambition extrêmement vaste, ou, au contraire à partir de l’idée qu’il fallait maintenir cette Économie Sociale et Solidaire dans la marge, qu’il fallait répondre à la question que m’avait posée Madame Aubry en me demandant un rapport sur le tiers secteur ? J’ai essayé tout de suite de la développer dans le premier sens.
En fait, la question que me posait Madame Aubry, c’était : est-ce qu’on a besoin d’une nouvelle forme d’entreprise à but social ? Très rapidement, j’ai répondu non, on a ce qu’il nous faut. On a ce qu’il faut, même s’il faut un gros travail d’adaptation pour que ça marche.
Mais pour y répondre, j’ai dû passer par tout un détour : qu’est-ce que l’Économie Sociale et Solidaire ? D’ailleurs, ça ne s’appelait pas comme ça à cette époque. Ça s’appelait le tiers secteur. Alors évidemment quand on dit “ tiers ”, c’est ni l’un ni l’autre, c’est un peu vague. Une grande partie de mon boulot, et en fait aussi des questions qui ont été débattues aujourd’hui, visait tout simplement à aller au-delà du mot tiers qui veut dire ni l’un ni l’autre.
Alors qu’est ce qu’il y a, d’habitude ? D’habitude on dit : il y a le secteur public et puis il y a l’économie marchande.
Le secteur public prélève les impôts et redistribue des services publics qui sont alloués sur l’ensemble du territoire, mis en ½uvre par des fonctionnaires et une administration et contrôlés par les députés. En gros. Et inversement, le marché, c’est des unités économiques ou tout simplement des entrepreneurs qui prennent l’initiative strictement privée de dire : “ Tiens, je vais offrir tel ou tel bien ou tel ou tel service à mes concitoyens ”. Et on voit si ça marche ou ne marche pas simplement par le fait que les consommateurs prennent ou ne prennent pas, achètent ou n’achètent pas. Si ça ne se vend pas, on arrête, si ça se vend, on continue, on développe la production.
Vous voyez que ça correspond à deux façons de socialiser, de “ faire société ”, de vivre ensemble. La première est extrêmement hiérarchique. Il y a un État qui dit : “ Je prends et je redistribue ”. La seconde, le marché, est extrêmement non hiérarchique, chacun offre et ceux qui n’ont rien à offrir offrent leur force de travail à un employeur.
Ces deux principes s’appellent la redistribution et l’échange. Or les anthropologues, et notamment Karl Polanyi, ont montré qu’en fait, le gros de l’économie, le gros de la vie matérielle, ne marchait pas du tout comme ça.
Dans la vie, si vous comptez en heures dépensées pour produire des services ou des biens, des choses utiles, l’essentiel du travail ne fonctionne pas du tout selon ces principes-là. Ou du moins, jadis, cela ne fonctionnait sur ce principe-là.
Tout fonctionnait selon ce qu’on appelle la réciprocité, c’est-à-dire que, un peu sur le mode du “ cela va de soit ”, chacun savait à peu près la place qu’il devait tenir, chacun offrait aux autres ce qu’il pouvait offrir. Et chacun s’attendait à ce que les autres lui offrent ce dont il aurait besoin au moment où il en aurait besoin. En fait, la structure de la famille élargie était un peu comme ça. Ça ne veut pas dire que c’était juste, attention. C’est la femme qui faisait le gros du travail et les hommes qui bénéficiaient du gros des services. Mais ce n’était pas un échange et ce n’était pas non plus de la redistribution. On se levait le matin et on savait qui devait faire quoi, c’était tout à fait normal. Le boulot qu’il y avait à faire s’apprenait de génération en génération, de mère en fille, de tante en nièce. Au-delà de la famille, il y avait des superstructures de la réciprocité. Dans mon enfance avallonnaise, il ne serait venu à l’idée de personne de créer une association ou ‘exiger une subvention pour organiser la fête du 14 juillet. Chacun savait exactement qui devait faire quoi, où était le mat de cocagne, où il avait été stocké, où on devait le mettre en place, qui devait tenir le violon pour faire danser les gens, où étaient les lampions, où étaient les guirlandes, où on avait stocké l’estrade, etc.
Dans un village moyen en 1950, c’est sur le mode du “ ça va de soi ” que la communauté savait très bien comment faire ses petites affaires. Un certain nombre de fonctions à destination de la communauté devait tout simplement être pris en charge par la communauté.
Cette espèce de troisième principe qui est beaucoup plus fondamental que les autres, beaucoup plus ancien d’une certaine façon, c’est lui qui met du liant dans la société.
Ça ne veut pas dire que c’est forcément bien fait, je ne suis pas en train de faire l’éloge d’un monde ancien où tout allait bien. Mais on s’aperçoit en réalité, et je me suis aperçu dans ma réflexion, que toute l’histoire du développement économique sous le capitalisme, en particulier depuis la Révolution française et surtout tout au long des XIXe et XXe siècles, a consisté à dire : “ Non, il n’y a que les deux premiers secteurs qui comptent ”. Ce que fait l’État et ce que font les entreprises commerciales.
Et petit à petit, cet énorme secteur de la réciprocité qui comprenait à la fois la famille, l’Église aussi, les Églises, la communauté villageoise et les communautés de quartiers a fondu. Et dans les années 1980, on s’est probablement retrouvé au point le plus bas du sens de la réciprocité, du sens de communauté. Les films qui commencent à avoir du succès à partir du milieu des années 1990, y compris Amélie Poulain récemment, ce sont des films de la nostalgie de la communauté, des films qui disent : “ Mais enfin, si on s’occupait à nouveau un peu plus les uns des autres, ça irait bien mieux ”.
Et je crois que c’est ça qui alimente, en particulier depuis la crise, le retour, je dis bien le retour, de la volonté de développer ce qu’on va finalement appeler l’Économie Sociale et Solidaire. Pourquoi est-ce que je dis le retour ? C’est très lié à l’idée qu’en fait, on a déjà des structures qui peuvent assumer l’Économie sociale et solidaire. Ce sont les associations, c’est la coopérative, c’est la mutuelle.
En fait, dès la Révolution Française, avant même que la loi Le Chapelier ne fixe le modèle du développement capitaliste, les gens commencent à réagir à l’idée qu’il n’y ait que l’État et les entreprises comme forme de socialisation entre les femmes et les hommes du pays. Très, très vite, vous voyez se développer des initiatives populaires, dès les années 1820 à Lyon avec sa première coopérative de consommateurs, qui disent : “ Non, ça ne va, on ne peut pas tout confier à l’État, on ne peut pas tout confier au marché ”.
Et, évidemment, il faut souligner que l’on ne peut pas confier tout ce qu’il reste à l’Église. Ce n’est pas un hasard si ce mouvement que les historiens appellent l’associationnisme ouvrier, c’est-à-dire la naissance, au sein du monde de travail, de ce qui va devenir, entre 1880 et 1920 pour simplifier, le syndicat, la coopérative, la mutuelle et les associations, est concomitant de la séparation de l’Église et de l’État. L’Église était un peu le secteur de l’État qui s’occupait de réciprocité. À partir du moment où les mouvements populaires disent : “ Eh bien non, on va organiser la réciprocité nous-mêmes, dans des coopératives, dans des associations ”, eh bien, en quelque sorte, l’Église tombe de l’État vers la société civile. D’ailleurs, elle est récupérée dans le cadre de la loi 1901 au titre de l’article sur les congrégations.
Donc le mouvement populaire, essentiellement ouvrier mais pas seulement, invente au XIXe siècle une réponse à un modèle dans lequel il y aurait uniquement l’État et l’économie marchande.
Je me suis penché, quand j’écrivais mon rapport, sur les débats qu’il y a eu à l’époque. Charles Gide essaye de faire la synthèse de ce qui, à l’époque, s’appelle l’économie sociale. Il fait un grand discours pour l’exposition universelle de 1900, où existe un pavillon de l’Économie sociale. Et les socialistes lui répondent, par la voix de Jean Jaurès, que "L’État est la coopérative suprême, celle vers laquelle tendent comme une asymptote toutes les autres formes de coopératives".
Extraordinaire vision ! Et Charles Gide a la même idée. C’est très intéressant, car ça nous donne une idée de ce qu’était l’Économie sociale à l’époque. Gide dit : “ Le destin de la mutuelle, c’est de devenir caisse obligatoire de sécurité sociale. Le destin de la coopérative, c’est de devenir service public ”. Prenez par exemple le gaz et l’électricité. On se rend compte qu’à l’époque, dans les quartiers populaires, dans les quartiers les plus pauvres, c’était souvent des coopératives qui mettaient en place les services publics.
Juste avant la conférence de Porto Alegre, j’ai vu exactement le phénomène inverse en Amérique Latine, en Argentine, dans la petite ville de Villa Carlos Paz, dans la montagne, près de Cordoba. Là, il y a eu la privatisation et c’est une seule coopérative, la même, qui a pris en charge à la fois la distribution de l’eau et la danse, l’animation culturelle. C’était intéressant de voir ça. Oui, d’une certaine façon, c’est une alternative à Vivendi.
Qu’est ce qu’il y a de commun entre l’eau et la culture, entre un service de redistribution de l’eau et l’offre de cours de danse et d’animation de fêtes ? C’est que, dans les deux cas, c’est un service qui s’adresse à la fois à la communauté tout entière et à chacun en particulier. Une bouteille, ça, c’est une pure marchandise. Il y a quelqu’un qui fabrique une bouteille, qui met de l’eau dedans et qui la vend dans le système marchand. Le système d’adduction d’eau qui est au robinet est tout à fait différent. Évidemment, à la fin, ça sera bien une personne qui boira. Mais le réseau d’eau, c’est quelque chose qui est ouvert à toute la communauté. Et chaque individu à la liberté, à tout moment, d’ouvrir son robinet ou de ne pas l’ouvrir. La culture, c’est pareil. Vous organisez une fête. Il y a des gens qui viennent y danser, individuellement ou par couple ou parfois les couples se forment sur place. Mais vous avez besoin de mettre la structure de la fête commune en place pour que chacun puisse en profiter. Et de ce fait il y a interactivité. C’est à la fois un service à la communauté et un service à chacun qui ne peut être pris en charge ni par l’économie marchande qui s’occupe d’individus qui achètent des marchandises, ni par la fiscalité car chacun pourra choisir d’en consommer plus ou moins. Donc il est assez logique qu’existent des formes de production qui répondent à cette double dimension. Des formes qui soient en plein dans l’économie marchande, car il y a des clients qui viennent danser ou pas danser, qui viennent prendre de l’eau ou pas prendre de l’eau. Mais qui, en même temps, répondent à la nécessité d’offrir un service à toute la communauté, indépendamment et au-delà de la somme des usagers, chacun en profitant plus ou moins. Quand vous regardez bien, c’est même un cas extrêmement général et c’est pour ça qu’existe le système, le principe, de réciprocité. Parce que, dans la plupart des cas, on n’est pas dans le système général de redistribution par l’État, dans lequel l’État prend par l’impôt et rend un service public. On n’est pas non plus dans la redistribution du système marchand où les entrepreneurs cherchent un client. Dans la plupart des cas, on est dans les deux à la fois. Et c’est ça, ce qui fait la part la plus importante de notre vie matérielle et même spirituelle et intellectuelle. Alors, à partir de ça, on comprend très vite qu’il est tout à fait normal que certaines formes de production soient à la fois marchandes et subventionnées en permanence. Pour autant qu’il y a un client, ça doit rester marchand, pour autant que c’est un service qui est offert à toute la communauté, c est normal que ce soit toute la communauté qui la paye. Et donc, dans la réalité concrète, il faut que l’agence, la coopérative, ou l’association qui offre ces deux services en même temps, bénéficie d’un double financement, de l’individu et de la communauté.
C’est pour ça que je citais la phrase de Jaurès sur cette tension qui existe dès la naissance d’un service de ce type, destiné à la fois à l’individu et à la communauté. Au départ, c’est une initiative de gens qui disent : “ C’est un besoin qui n’est pas rempli, je vais le faire ”. Puis on s’aperçoit que ça bénéficie à toute la communauté. Et on se dit : “ Mais si ça bénéficie à toute la communauté, pourquoi ce n’est pas l’État qui le fait ? ” Et on retrouve toujours cette tension. Tension entre d’un côté des initiatives venues de la base, d’individus, de coopératives ou d’associations qui se forment en se disant : “ Je vais faire ça pour des amis, pour des gens autour de moi ”. Et qui au bout d’un certain temps se disent : “ Oui, mais c’est nous qui faisons le boulot, il n’y a aucune raison qu’on ne bénéficie pas d’un financement public ”. Et d’un autre côté, des gens qui se disent : “ On ne veut pas de bureaucratie, c’est une initiative venue de la base, on ne veut pas de l’État ”.
On est donc en permanence pris dans cette espèce de tension entre les créateurs, ceux qui sont du côté de la fleur, de ce qui naît, du printemps, qui disent : "C’est une invention venue de la base et il faut que ça reste quelque chose qui jaillit de la société civile". Et puis ceux qui gèrent et qui disent au bout d’un certain temps : "Puisque ça sert à tout le monde, puisque c’est en fait un service public, il n’y a pas de raison que l’on ne soit pas payé comme des fonctionnaires". Alors les premiers vont dire : “ Des fonctionnaires ? vous n’y pensez pas. Après on va nous demander d’être recruté par concours et qu’il y ait de l’avancement à l’ancienneté, etc..”.
Jaurès dit que la coopérative tend vers l’État, mais comme une asymptote qui jamais n’atteint sa limite. Il faut que la tension reste vivante. Or cette tension, elle était morte dans les années 1950-1960. On peut dire que les associations et les coopératives, dans l’immédiat après-guerre, ont connu comme un couronnement de tout ce qu’elles avaient inventé depuis le XIXe siècle. Mais en même temps, ce couronnement les a ossifiées. Les associations, les mutuelles et les coopératives sont devenues des institutions de quasi-état. En gros, on a créé la sécurité sociale comme un système de redistribution et on a confié au secteur associatif le soin d’offrir le service correspondant.
Si vous regardez aujourd’hui la réalité du mode associatif, c’est, je dirais, facilement 40 % de secteur para-médical. Le reste est du secteur de la jeunesse et des sports, c’est-à-dire du parascolaire ou du secteur sportif. En gros. Les statistiques exactes sont dans mon rapport. C’est le modèle de 1936, d’une certaine façon révisé en 1945. Cet associationnisme populaire s’est transformé en quasi État, quasi service public. C’est un couronnement, car c’était d’une certaine façon leur ambition, c’est ce qu’ils avaient voulu faire depuis qu’ils étaient nés. Mais en même temps, les gens commençaient à avoir un rapport à ces associations comme si c’était un service public ou comme si c’était un secteur marchand. Je prends l’exemple de l’UNCM, Union Nationale des Centres de Montagne, devenue UCPA, Union des Centres de Plein Air. Vous n’avez pas l’impression que ce soit l’expression du monde associatif. Quand vous allez dans un stage de l’UNCM, vous avez soit l’impression de payer l’hôtel et de payer un peu moins cher, soit d’être dans un service public qui serait payant. Vous payez une cotisation pour y adhérer quand même, vous entrez dans une association pour effectuer un stage de l’UNCM. Même chose pour les Auberges de Jeunesse.
Donc, d’une certaine façon, le mouvement associatif est devenu un satellite de l’appareil de l’État Providence. Quant au mouvement mutualiste, il est devenu un complément de la sécurité sociale. Le gros des mutuelles, c’est aujourd’hui les complémentaires de la sécurité sociale. Et les coopératives, c’est encore pire, elles ont été condamnées à se couler dans le moule des entreprises jusqu’à exceller dans ce modèle. Le Crédit Agricole, on ne peut pas dire que ce soit l’outil de l’alternative financière. Au contraire, ça a été l’outil de la modernisation hyper productiviste de l’agriculture. Comme le Crédit Mutuel et d’autres, qui sont devenus l’outil de l’accompagnement financier de ce qu’on a appelé le fordisme, de la mise en place de la société de production de masse et de consommation de masse.
C’est après la crise de ce modèle, quand ni l’État ni les entreprises n’ont plus été capables d’assurer le plein emploi et une situation équitable pour tout le monde, qu’on a revu à nouveau, comme de petites fleurs, des jeunes pousses, qui ont commencé à dire : “ On va faire autre chose ”. Ça s’appelait de l’économie autonome ou alternative à l’époque. Puis, petit à petit, elles se sont institutionnalisées, elles aussi. Et quelle forme avaient-elle prise ? La forme association, la forme coopérative. Ça se faisait à peu près au moment où j’écrivais mon rapport. Ce n’est pas loin d’ici, au congrès du Réseau de l’Économie Alternative et Solidaire, à la Belle de Mai à Marseille, que finalement les vieux du mouvement coopératif, mutualistes et associatif ont reconnu leurs petits-enfants et que les enfants ont reconnu les grands-parents. En disant que, finalement, ce mouvement de l’économie alternative né après 1981 avait rejoint ses ancêtres un peu rassis qu’étaient devenues l’économie sociale, la coopérative, la mutuelle, l’association etc.
Alors maintenant, qu’est-ce qu’on peut faire ? Je crois que d’abord il faut partir de cette idée que, dans notre société formidablement réduite à des individus complètement isolés, où il n’y a plus de communautaire, où on crève de nostalgie du communautaire, où on crève de solitude, où on crève d’insécurité et de peur du voisin, il faut retisser les liens sociaux.
Ça ne sera pas du tout la même chose que ce qui s’est fait dans le secteur socio-culturel. On ne refera pas de la même façon. On ne refera pas les années 1950. On n’est plus dans une situation où les gens vont spontanément dans les patronages laïques, devenus depuis ciné-club, maison des jeunes et la culture. À l’époque, en 1950, on sortait d’un monde encore très communautaire, aussi bien en rural qu’en urbain. Les gens n’avaient pas chacun leur télévision, les gens n’avaient pas chacun leur voiture, etc. Donc, les structures communautaires de services publics dans le domaine culturel étaient la façon normale d’accéder à la culture. Aujourd’hui c’est tout à fait différent.
Nous avons des gens qui ont chacun leur téléviseur, chacun leur chaîne Hi-Fi. Les gens partent au contraire de situation de pure consommation individuelle et savent très bien que ce n’est pas suffisant. C’est pour ça qu’ils se retrouvent dans les rave party, pour se retrouver. Il faut réinventer du collectif à partir d’un point extrême d’individualisation. Ça c’est la toute première chose qu’il faut se mettre dans la tête. Ça ne va pas être simple.
Réinventer du collectif, retisser du lien social. Dans la culture, c’est évident, mais dans la famille, c’est pareil. Le problème fondamental c’est que, quand on va avoir, demain, en 2020, 150 000 centenaires en France, qui va s’occuper d’elles ? Je l’avais dit la dernière fois que je suis venu à Aix. Pas leurs filles qui auront 80 ans. Pas leurs petites filles qui auront, je simplifie, 60 ans, qui auront été féministes toute leur vie. Elles ne trouveront pas normal de s’occuper de leur grand-mère 24 heures sur 24. Ce n’est pas la vocation des femmes de devenir servantes d’une grabataire pendant leur temps libre. Alors qui le fera ? Ça ne sera pas non plus les fonctionnaires. Le mode de fonctionnement de la fonction publique n’est pas adéquat à ce type de travail. Pour aider, il faut un jour y consacrer 5 minutes, le lendemain y consacrer peut-être 3 heures. Il faut aider une personne à vivre son affaiblissement, sa dépendance croissante, à affronter le mort. Ce n’est pas le travail de fonctionnaires. Ce n’est pas non plus le travail de Vivendi qui enverra des personnes chronométrées à 14 minutes 27 secondes à aller servir un repas froid à un retraité du 43 bd de la République. Ce n’est pas comme ça que ça marche non plus. C’est forcément quelque chose qui vit sur un mode où on ne compte pas son temps. Ça ne peut pas être lucratif, ça ne peut pas être fondé sur le profit, ça ne peut pas être fondé sur la redistribution administrative.
Donc, ça appartient évidemment au mode associatif. Il est évident qu’il s’agit de servir une personne en particulier. Il faut bien qu’à la fois, la cliente ou sa famille et la Caisse Nationale d’Allocations Familiales payent. Je dis la cliente car, à cette âge-là, il n’y aura plus guère que des femmes. Mais ce qui est important, c’est que le réseau existe. C’est que l’association qui offre des services à domicile existe en permanence, qu’elle soit disponible pour la communauté. Qu’elle reconstitue en quelque sorte ce qui était offert gratuitement soit par la famille, soit par la communauté villageoise, quand tout le monde trouvait normal d’aller s’occuper de son voisin, avec tout ce que ça représentait d’oppressant ou, pire encore, par la société patriarcale dans lesquelles les femmes étaient obligées de s’occuper des grabataires de la famille, vu que “ C’était la vieille qui avaient l’oseille ”, comme disait Jacques Brel.
Donc il y a bien un problème, et reconstruire demain de la communauté va demander un montage institutionnel qui est forcément non lucratif et non administratif. Or, nous avons la forme pour faire ça, c’est l’association et c’est la coopérative. Qui, déjà, par définition sont non lucratives. Attention, ce n’est pas la définition de l’association, une association peut être lucrative, ne confondons pas la loi 1901 et le code des impôts. Mais, les associations non lucratives peuvent très bien faire ça, et les coopératives, pour autant qu’elles ne se distribuent pas trop d’excédent, peuvent très bien faire ça.
Alors se pose la question : “ Qu’est ce qui empêche l’association et la coopérative de faire ça ? ” À partir du moment où on décide que les associations et coopératives doivent prendre ça en charge, il est bien évident qu’elles doivent être rémunérées pour le faire, sous un double aspect, parce qu’elles offrent des services aux particuliers et parce qu’elles offrent des services à la communauté. J’emploie le mot “ rémunérer ” et pas “ payer ” car “ communauté ”, “ municipalité ”, “ rémunérer ” appartiennent à la même famille et viennent tous du mot munus qui veut dire le don et la charge en même temps, ce que l’on donne aux autres en ayant la responsabilité de le faire. C’est le principe de la réciprocité.
Comment est-ce qu’on peut réaliser ça ? Jusqu’à présent, et c’est ce qui bloque, on le faisait au coup par coup. Une association qui se dit : “ Je prends en charge ici le football, je prends des jeunes et j’offre à la communauté un endroit où occuper les jeunes qui sinon pourraient faire des bêtises. Et pour les jeunes qui aiment ça, je leur apprends le football ”. C’est à la fois pour les individus en particulier et pour toute la communauté. C’est clair, une association qui propose ça attend des subventions. Parce que, pour autant que le service d’enseigner le football est un service qui tient lieu de cours particulier, c’est au jeune footballeur de payer. Pour autant que c’est toute la communauté qui a intérêt à ce que ça existe (en plus, le club peut devenir champion, on ne sait jamais), c’est normal que la communauté paye...
Au début, les gens sont volontaires, bénévoles, parce qu’ils trouvent que c’est bien de donner du temps à la communauté. Puis, la courbe rejoignant son asymptote, s’apercevant qu’ils rendent un service public, ils se disent : “ Mais pourquoi je fais ça gratuitement ? En plus, les usagers exigent que je continue, et en plus, en cas de risque, je suis pénalement responsable alors que je rends un service à la communauté ”.
Vous voyez qu’il faut essayer de trouver un moyen pour assurer le double financement sans qu’il faille perdre son temps à quémander les subventions. Dans la réalité concrète d’aujourd’hui, toute l’économie sociale et solidaire passe son temps à chercher des financements. Dans le secteur le plus difficile, celui qui s’occupe de l’insertion, pour trois personnes qui bossent, il en faut un quatrième qui cherche des financements.
Ma proposition de loi consiste à définir qui sont les associations et coopératives à but social et solidaire, celles qui rendent des services à la fois dans le secteur marchand et pour le bien de toute la communauté. Celles qui auraient obtenu un tel label auront droit automatiquement à des abattements de charges, d’impôts, ou à des subventions. Et ça, c’est la loi qui doit le faire, c’est le travail des députés, pas d’une administration..
Une fois qu’on a bien défini l’ESS, normalement, n’importe quelle association ou coopérative rentrant dans une caseouunegrille définie par les députés selon la définition de l’économie sociale et solidaire, pourrait avoir droit automatiquement à la forme la plus banale d’aide, c’est-à-dire la dispense d’impôts et de cotisation. Ça ne coûterait rien à la communauté puisqu’elle embaucherait des chômeurs qui ne paient déjà pas d’impôts ni de cotisation. En revanche, il faut évidemment quand même vérifier que c’est bien une entreprise à vocation sociale et solidaire qui se lance, coopérative ou association. Il faut qu’il y ait une reconnaissance. Est-ce que c’est le préfet qui va reconnaître ? Ou le Secrétariat d’État à l’Économie sociale et solidaire ?
Moi j’ai dit non, c’est d’abord les pairs. Quand c’est une régie de quartier qui se crée, ce sont les autres régies de quartiers qui vont dire : “ Oui, c’est vraiment une régie de quartier, ce ne sont pas des mercantiles qui essaient de se faire passer pour une régie de quartier ”.
J’avais donc proposé tout un système d’auto-reconnaissance permettant d’obtenir un label, le label permettant d’avoir droit automatiquement, sans avoir à quémander au préfet, à des subventions, sous forme notamment de dispense de cotisation.
Alors, maintenant, la toute dernière question, la première, en fait : “ Pour qui ? L’Économie sociale et solidaire, pour qui ? ”
Je me suis aperçu qu’il y avait une ambiguïté terrible, notamment chez mes collègues de l’administration et du gouvernement, sur ce que veut dire le mot social. On est arrivé, après vingt ans de libéralisme, à dire : “ Le social, c’est s’occuper des pauvres ”. Et bien non ! Le social, c’est de faire qu’il n’y ait plus de pauvres et que tout le monde s’occupe les uns des autres.
J’ai suivi les négociations de l’époque sur la fameuse Instruction fiscale pour savoir quelles étaient les associations qui avaient le droit d’être dispensées de cotisations, etc. J’ai suivi les négociations dans le secteur du tourisme pour voir comment ça se passait. Il y avait deux lignes qui s’affrontaient. Ceux qui disaient : “ Le tourisme social, c’est pour les pauvres, les jeunes des banlieues que l’on veut sortir de l’étuve de l’été pour qu’ils ne fassent pas brûler des voitures. C’est ça le but de la man½uvre ”. Puis il y a une autre définition qui remontait à une autre tradition, de 1945 voire 1936, qui disait : “ Ah non ! Le social, c’est le brassage social, c’est que tout le monde puisse partir en vacances et si possible dans les mêmes endroits ”.
Je crois qu’il faut dire de façon très claire que l’Économie sociale et solidaire n’est pas une économie des pauvres pour les pauvres. Si on fait ça, c’est du clientélisme. Si on fait ça, c’est enfermer les pauvres dans un sous secteur, et l’Économie sociale et solidaire dans un ghetto. Non, l’Économie sociale et solidaire, c’est la reconstruction de la communauté pour tout le monde. Alors évidemment les riches n’en ont pas besoin. Ils ont les moyens, avec l’argent, de se reconstituer autour d’eux une pseudo-communauté, avec une lectrice ou une accompagnatrice chez eux, une bonne d’enfant, une gouvernante etc... Ils n’ont pas besoin de reconstituer la famille via l’associatif, ils ont l’argent pour la reconstituer. Je ne dis pas que c’est bien fait, je dis qu’ils ont les moyens de le faire.
Mais l’idée que l’Économie sociale et solidaire soit uniquement pour les pauvres me paraît une idée parfaitement erronée et je crois que si on s’en tient là, on n’offrira pas à l’Économie sociale et solidaire tout son développement.
Je pense très profondément que l’Économie sociale et solidaire est la réponse au sentiment d’isolement, et, pour autant que l’on puisse y répondre, à la peur du vieillissement et de la mort, la réponse à la crise de la famille, la réponse à la crise de l’État. Elle propose en fait une reconstitution, sur des bases librement choisies, du sentiment de la communauté, dans une société qui est devenue complètement individualiste. C’est une ambition pour tout le monde. Elle est profondément liée au concept même d’écologie, c’est-à-dire au rapport entre les individus, leur société et leur environnement, puisque, justement, elle s’occupe de tout ce qui est commun quand on vit en société. Et commun, ce n’est pas que pour la frange la plus pauvre.
Et je crois que la réponse que l’on peut donner à la question initiale est : “ L’Économie sociale et solidaire, oui, et pour tout le monde ”. Voilà ce que je voulais dire en introduction à ce débat. ”
Questions à Alain Lipietz
Joël Gombain, étudiant : “ Qu’en est-il, pour ce projet de société sociale et solidaire, qu’en est-il de cette tension entre liberté et égalité, vieille tension au c½ur de tous les projets intellectuels de société ? J’ai le sentiment qu’à travers ce nouveau modèle de société qu’aujourd’hui on essaie de penser, on peut peut-être aboutir, aller vers une solution plus satisfaisante que cette tension entre le libéralisme et le modèle communiste. ”
Alain Lipietz : On arrive toujours à une tension entre liberté et égalité. Cela correspond d’une certaine façon à la redistribution qui est très égalitaire et à l’échange qui est liberté. Le mot "libéralisme" veut dire à la fois le libre-échange et la liberté politique. On sait très bien que la liberté détruit l’égalité et que l’égalité, quand elle est imposée, empêche la liberté. Et la réponse c’est la fraternité. La fraternité, c’est ça, c’est l’idée de réciprocité. La fraternité, c’est de ne pas attendre d’avoir déjà eu pour donner. C’est donner en se disant : “ Un jour ou l’autre, l’autre donnera pour moi ”. Et on se sent déjà responsable de donner. C’est ce qu’on appelle la réciprocité. L’Économie sociale et solidaire répond très exactement à ça, dans une situation complètement dégradée au profit du libéralisme. Il n’y a plus que des hommes et femmes libres, les uns d’être chômeurs et précaires, les autres de faire des profits colossaux. On ne va pas revenir vers le fantasme d’égalité dont le XXe siècle a donné des exemples assez lamentables. Donc, la seule solution qui nous reste pour le XXIe siècle, c’est de construire une société fraternelle ou communautaire, comme vous voulez, où se crée une libre association de gens qui donnent les uns pour les autres. Ça a l’air idéaliste comme ça, mais il faut se rappeler que la famille ne peut fonctionner que comme ça. La communauté ne fonctionne que comme ça.
Question : “ La participation des salariés à leur propre entreprise peut-elle être une réponse ? ”
A. Lipietz : “ Il faut bien distinguer le caractère marchant et le caractère profitable. Que les ouvriers salariés participent au caractère profitable de l’entreprise et que, par ce biais, ils participent à la direction de l’entreprise, je n’ai rien contre. Il a deux façons pour que les salariés participent à la direction et aux fruits de l’entreprise. C’est soi directement en tant que salarié et ça c’est le modèle de co-gestion de l’entreprise, c’est le modèle allemand et c’est bien, c’est une voie à exploiter. Soit la co-propriété. Il faudra combiner les deux, probablement. Mais ça ne répond pas à la question et au fait que l’économie ne peut être que marchande. Un salarié co-propriétaire de son entreprise, même un salarié coopératif n’intègre pas obligatoirement dans son comportement le fait qu’il sert la communauté. Et donc la participation des salariés à leur propre entreprise, à sa direction ou à l’usufruit est une réponse à la question de l’injustice du système du profit, elle n’est pas une réponse au caractère abstrait, indifférencié, marchand de l’économie. À la limite, on peut avoir des salariés autogestionnaires coupés du reste du monde qui disent : "On pollue ? On s’en fiche, du moment que c’est profitable, etc." La prise en compte par chacun de l’espèce de halo sociétal, du halo communautaire qui devrait entourer chacun de nos actes productifs, on n’y répond pas dans la co-participation des salariés dans l’entreprise.
Question : “ Est-ce que l’on peut accepter la privatisation des services publics à partir du moment où l’on définirait un service universel ? ”
A. Lipietz : “ C’est un vieux débat. On passe son temps à ça, au Parlement européen. Un des problèmes, c’est que les services publics n’ont pas du tout la même définition d’un pays à l’autre. Pas du tout. On essaie de définir un service universel. On définit ce qui doit être rendu au public, que ce soit pris en charge par le service public, par le privé, par le coopératif ou par l‘associatif. Le reste est du supplément. Je pense que c’est un travail de dentellière ou du tonneau des danaïdes ou de Sisyphe, car ça recommencera tout le temps. Je crois que l’on n’y arrivera jamais. Qu’est-ce qui est service universel ? Qu’est ce qui ne l’est pas ? On peut prendre un exemple : Est-ce que l’Internet est un service public ? On considère que le téléphone l’est. Et que donc l’accès à Internet l’est ? Oui, mais haut débit ou pas haut débit ? D’ici quelque temps, quelqu’un qui n’aura pas le haut débit n’aura accès à rien d’intéressant. Parce que la norme sera que n’importe quelle page de web demande 3 minutes à télécharger si vous n’avez pas le haut débit. Donc si vous ne l’avez pas, vous n’avez pas vraiment accès. C’est tellement mobile et variable qu’il faut admettre un peu de flexibilité là-dedans. Ceci dit, je ne crois pas que l’aviation doive être un service public. Pour un pays comme la France autant le train peut être un service public, autant se déplacer avec un maximum de pollution doit être lourdement taxé pour qu’on ne le fasse que quand c’est vraiment utile ”.
Ce texte est [téléchargeable, sous format word (103 ko) et sous format pdf (40 ko).
(note : Pour visualiser ce texte en pdf vous devez télécharger, gratuitement,
Acrobat reader).


-
[18 juillet 2014]
Gaza, synagogues, etc

Feu d’artifice du 14 juillet, à Villejuif. Hassane, vieux militant de la gauche marocaine qui nous a donné un coup de main lors de la campagne (...)
-
[3 juin 2014]
FN, Europe, Villejuif : politique dans la tempête

La victoire du FN en France aux européennes est une nouvelle page de la chronique d’un désastre annoncé. Bien sûr, la vieille gauche dira : « C’est la (...)
-
[24 avril 2014]
Villejuif : Un mois de tempêtes

Ouf ! c’est fait, et on a gagné. Si vous n’avez pas suivi nos aventures sur les sites de L’Avenir à Villejuif et de EELV à Villejuif, il faut que je (...)
-
[22 mars 2014]
Municipales Villejuif : les dilemmes d'une campagne

Deux mois sans blog. Et presque pas d’activité sur mon site (voyez en « Une »)... Vous l’avez deviné : je suis en pleine campagne municipale. À la (...)
-
[15 janvier 2014]
Hollande et sa « politique de l’offre ».

La conférence de presse de Hollande marque plutôt une confirmation qu’un tournant. On savait depuis plus d’un an que le gouvernement avait dans les (...)

-
[11 mai 2016]
Dans l’état où nous sommes...
Allergique à Fesse-bouc je me permets de commenter ici votre article "Dans (...) -
[17 décembre 2015]
Cliquez sur le smiley choisi
May I just say what a comfort to discover an individual who genuinely knows (...) -
[18 juillet 2015]
Démocratie grecque
Cher Joke, dernier dialoguiste de ce site (qui reste très lu) Je ne dis pas (...) -
[9 juillet 2015]
Démocratie grecque
Puisque je suis sur votre blog, pour les félicitations, je vais en profiter (...) -
[9 juillet 2015]
Gaza, synagogues, etc
Félicitations aux mariés ! Et longue vie (militante) ensemble. (Je renonce à (...)

- 2000 à 2012
-
[13 avril 2014]
La SNCF et la Shoah -
[13 avril 2014]
La seconde crise écologique mondiale -
[6 janvier 2013]
De la crise alimentaire à la crise des subprimes : les limites d’un modèle libéral-productiviste -
[13 décembre 2012]
Pour un protectionnisme universaliste -
[20 septembre 2012]
L’Union européenne, épicentre d’une crise systémique ? - 2002
-
[10 décembre 2002]
L'art du portrait -
[28 novembre 2002]
Congrès des Verts : l'après-Voynet -
[27 novembre 2002]
Les Verts retrouvent du charme à Alain Lipietz -
[25 novembre 2002]
Le retour en force de Lipietz -
[20 novembre 2002]
Imposer les normes de l'UE au sein du Comité de Bâle - Économie
-
[15 April 2019]
Monetary policy in time of climate crisis -
[15 avril 2019]
Capitalisme et écologie, vraiment ? -
[23 septembre 2015]
L’alternative est européenne ou ne sera pas -
[2015年8月17日]
グリーンディールー自由主義的生産性至上主義の危機とエコロジストの解答 -
[12 mars 2015]
Et si on osait le revenu de base ?

-
[8 juillet 2017]
Économie sociale et solidaire, mouvements sociaux et écologie. Le cas français. -
[5 avril 2017]
L’Économie sociale et solidaire et l’écologie, de l’émergence antédiluvienne à la banalisation. Le cas français. -
[5 de agosto de 2015]
Las políticas sociales en América latina : laboratorio mundial -
[10 March 2015]
Empowerment and Émancipation -
[31 January 2014]
The Anthropological Crisis and the Social and Solidarity Economy